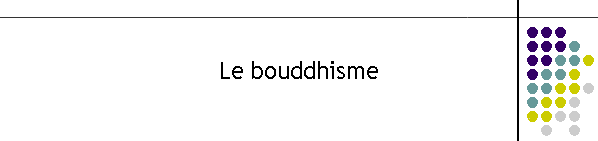|

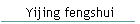
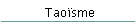



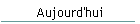

| |
17/04/12
Le bouddhisme
 Venons-en à la religion
chinoise que l’on croit, bien à tort, le mieux connaître : le bouddhisme. Le
bouddhisme n’est pas un mais multiple, et il revêt un caractère tout
particulier dans le monde chinois, Japon compris. Mais n’anticipons pas. Venons-en à la religion
chinoise que l’on croit, bien à tort, le mieux connaître : le bouddhisme. Le
bouddhisme n’est pas un mais multiple, et il revêt un caractère tout
particulier dans le monde chinois, Japon compris. Mais n’anticipons pas.
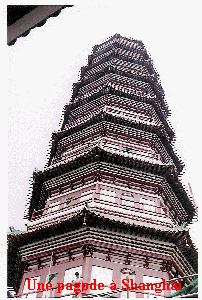 Appelé couramment le Bouddha, le
prince Siddharta (VIème s. av. J-C) n’a été ni le premier ni le
dernier bouddha. D’autres avant lui auraient échappé au cycle du samsara
et atteint l’éveil (bodhi), mais lui a découvert la « voie médiane
», entre ascèse et plaisir, qui mène le plus sûrement à l’éveil. D’autres
ont suivi son exemple et sont également devenus des bouddhas. Appelé couramment le Bouddha, le
prince Siddharta (VIème s. av. J-C) n’a été ni le premier ni le
dernier bouddha. D’autres avant lui auraient échappé au cycle du samsara
et atteint l’éveil (bodhi), mais lui a découvert la « voie médiane
», entre ascèse et plaisir, qui mène le plus sûrement à l’éveil. D’autres
ont suivi son exemple et sont également devenus des bouddhas.
Religion sans dieux, le bouddhisme ? Cette idée reçue est fausse. Siddharta
lui-même n’est-il pas représenté comme protégé par des dieux et en lutte
contre d’autres ? Par ailleurs, les bouddhas eux-mêmes ainsi que les bodhisattvas
(nous reviendrons sur ce terme) sont, surtout dans certaines écoles
bouddhiques, vénérés comme des dieux.
 Dès le IVème s. av.
J-C, la diffusion du bouddhisme dans des peuples de cultures différentes a
entraîné la scission en 18 écoles formant ce que l’on a appelé le « petit
véhicule » hînayâna. Il ne reste guère de ces écoles que le
bouddhisme theravada répandu surtout au Sri Lanka, en Birmanie et en
Thaïlande. Il s’était également répandu dans l’actuelle Indonésie avant
d’être supplanté par l’islam. S’il existe un
bouddhisme sans dieux, celui-ci en est le plus proche. Dès le IVème s. av.
J-C, la diffusion du bouddhisme dans des peuples de cultures différentes a
entraîné la scission en 18 écoles formant ce que l’on a appelé le « petit
véhicule » hînayâna. Il ne reste guère de ces écoles que le
bouddhisme theravada répandu surtout au Sri Lanka, en Birmanie et en
Thaïlande. Il s’était également répandu dans l’actuelle Indonésie avant
d’être supplanté par l’islam. S’il existe un
bouddhisme sans dieux, celui-ci en est le plus proche.
Un autre schisme est apparu plus tard avec les écoles du « grand véhicule
» mahâyâna qui, par la Route de la soie, ont gagné la Chine et le
Japon. On y insiste sur l’importance des bodhisattvas, les « bouddhas
en devenir », qui peuvent avoir choisi de ne pas quitter le monde et de
continuer à se réincarner pour enseigner les hommes. Le bouddhisme du grand
véhicule a créé toute une mythologie de bouddhas et bodhisattvas
célestes, véritables déités apparentées à la mythologie des premiers temps
de l’hindouisme.
 Du mahâyâna est issu un
nouveau courant, appelé tantra ou bouddhisme tantrique, mais aussi mantrayâna
(véhicule des chants sacrés) ou vayrayâna (véhicule de l’éclair).
Il insiste sur le rituel et le symbolisme et recommande des méthodes permettant
l’expérience immédiate de l’éveil. C’est le bouddhisme du Tibet, du
Népal, de l’Asie centrale chinoise et de la Mongolie. C’est aussi le
bouddhisme que l’on connaît en Europe et aux États-Unis depuis l’invasion
du Tibet par la Chine. Dans le bouddhisme tantrique, les bodhisattvas
revêtent une importance particulière. Ce sont leurs réincarnations qui
dirigent les grands ordres religieux (Bonnets rouges, Bonnets jaunes…) : l’actuel
DalaÏ Lama n’est-il pas censé être la 14ème réincarnation d’Avalokitesvara,
bodhisattva de la compassion ? Du mahâyâna est issu un
nouveau courant, appelé tantra ou bouddhisme tantrique, mais aussi mantrayâna
(véhicule des chants sacrés) ou vayrayâna (véhicule de l’éclair).
Il insiste sur le rituel et le symbolisme et recommande des méthodes permettant
l’expérience immédiate de l’éveil. C’est le bouddhisme du Tibet, du
Népal, de l’Asie centrale chinoise et de la Mongolie. C’est aussi le
bouddhisme que l’on connaît en Europe et aux États-Unis depuis l’invasion
du Tibet par la Chine. Dans le bouddhisme tantrique, les bodhisattvas
revêtent une importance particulière. Ce sont leurs réincarnations qui
dirigent les grands ordres religieux (Bonnets rouges, Bonnets jaunes…) : l’actuel
DalaÏ Lama n’est-il pas censé être la 14ème réincarnation d’Avalokitesvara,
bodhisattva de la compassion ?
 Revenons au grand
véhicule, présent en Chine, au Japon et au Vietnam. Il comporte plusieurs
écoles dont la plus connue est le bouddhisme chan 禪 chinois, appelé zen
au Japon. Si les monastères demeurent le conservatoire d’un bouddhisme
spirituel, le bouddhisme du grand véhicule pratiqué par le peuple est
fortement influencé par le panthéon taoïste. Les bouddhas sont vénérés
comme des divinités de premier rang, les bodhisattva comme des divinités de
second rang. Des assimilations sont fréquentes. Ainsi, la déesse Kuanyin,
sans doute la divinité la plus populaire en Chine, est assimilée au bodhisattva
de la compassion Avalokitesvara, encore lui. Revenons au grand
véhicule, présent en Chine, au Japon et au Vietnam. Il comporte plusieurs
écoles dont la plus connue est le bouddhisme chan 禪 chinois, appelé zen
au Japon. Si les monastères demeurent le conservatoire d’un bouddhisme
spirituel, le bouddhisme du grand véhicule pratiqué par le peuple est
fortement influencé par le panthéon taoïste. Les bouddhas sont vénérés
comme des divinités de premier rang, les bodhisattva comme des divinités de
second rang. Des assimilations sont fréquentes. Ainsi, la déesse Kuanyin,
sans doute la divinité la plus populaire en Chine, est assimilée au bodhisattva
de la compassion Avalokitesvara, encore lui.
   |