|

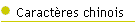

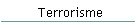
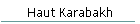
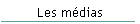
| |
17/04/2012
  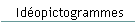  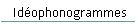 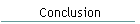
L'étymologie de nos langues occidentale met en jeu les sons et
accessoirement l'orthographe. Il n'en va pas de même du chinois, très pauvre
en sons, qui est avant tout une langue écrite. Si l'on veut rechercher
l'origine d'un mot, c'est dans sa graphie qu'il faut fouiller. Recherche
passionnante car elle nous fait remonter les millénaires : si l'écriture
chinoise n'est pas, loin s'en faut, la plus vieille du monde, elle est celle qui
connaît la plus ancienne tradition continue. Les inscriptions oraculaires
datant au moins du XIVème siècle avant notre ère (certains
spécialistes les font même remonter à 2.000 ans avant notre ère !) peuvent
encore reconnus comme les modèles des caractères aujourd'hui employés par les
Chinois.
 Nul
ne peut donc comprendre la structure d'un caractère sans remonter à sa forme
originelle, souvent ancienne de quelque 3.500 ans au moins. Peu de Chinois en
sont capables. Prenons pour exemple le caractère wang,
"espérance", ci-contre. On y distingue trois éléments. Tout bon
connaisseur de la langue chinoise reconnaît en bas un élément qui peut
désigner soit le roi, soit une sphère ; en haut à gauche, la mort ;
en haut à droite, ce peut être soit la lune, soit la chair. Nous voici bien
avancés. On peut essayer de combiner ces éléments dans tous les sens, on
n'aboutit à rien qui évoque l'espérance. Minute, m'objecte-t-on :
l'élément inférieur se prononce wang, il peut donc avoir une valeur
phonétique. Bon. En haut à gauche on retrouve également le son wang.
Et comment expliquer le reste du caractère ? Nous y reviendrons à la fin de
cet exposé. Nul
ne peut donc comprendre la structure d'un caractère sans remonter à sa forme
originelle, souvent ancienne de quelque 3.500 ans au moins. Peu de Chinois en
sont capables. Prenons pour exemple le caractère wang,
"espérance", ci-contre. On y distingue trois éléments. Tout bon
connaisseur de la langue chinoise reconnaît en bas un élément qui peut
désigner soit le roi, soit une sphère ; en haut à gauche, la mort ;
en haut à droite, ce peut être soit la lune, soit la chair. Nous voici bien
avancés. On peut essayer de combiner ces éléments dans tous les sens, on
n'aboutit à rien qui évoque l'espérance. Minute, m'objecte-t-on :
l'élément inférieur se prononce wang, il peut donc avoir une valeur
phonétique. Bon. En haut à gauche on retrouve également le son wang.
Et comment expliquer le reste du caractère ? Nous y reviendrons à la fin de
cet exposé.
C'est vrai, pour analyser un caractère chinois, il faut le
décomposer, à condition du moins qu'il soit décomposable. Mais c'est sous sa
forme originelle qu'il faut le démonter.
 La
plus ancienne écriture chinoise connue, nous l'avons dit, est celle de ces
inscriptions divinatoires sur os ou sur écaille de tortue appelées justement jiaguwen,
"écriture sur écaille et sur os". Si l'on pouvait retourner
l'écaille ventrale de tortue ci-contre, on observerait de petits puits ronds
creusés à espaces réguliers. Cette écaille était ensuite présentée à la
flamme et il se produisait sur l'autre face, celle ici visible, des fissures en
forme de T dont l'oracle interprétait la forme pour donner la réponse céleste
à la question posée. A une certaine époque, on est venu à rédiger les
questions posées puis les réponses, en utilisant une écriture sans doute
apparue peu de temps avant mais dont l'unique support qui se soit conservé est
ces os et écailles divinatoires. La
plus ancienne écriture chinoise connue, nous l'avons dit, est celle de ces
inscriptions divinatoires sur os ou sur écaille de tortue appelées justement jiaguwen,
"écriture sur écaille et sur os". Si l'on pouvait retourner
l'écaille ventrale de tortue ci-contre, on observerait de petits puits ronds
creusés à espaces réguliers. Cette écaille était ensuite présentée à la
flamme et il se produisait sur l'autre face, celle ici visible, des fissures en
forme de T dont l'oracle interprétait la forme pour donner la réponse céleste
à la question posée. A une certaine époque, on est venu à rédiger les
questions posées puis les réponses, en utilisant une écriture sans doute
apparue peu de temps avant mais dont l'unique support qui se soit conservé est
ces os et écailles divinatoires.
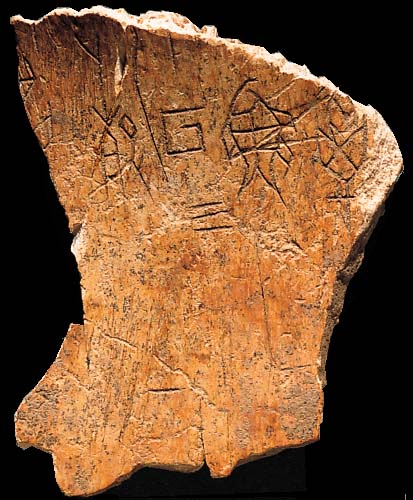 Ces caractères primitifs, pour beaucoup d'une grande beauté,
peuvent être classés en pictogrammes, idéopictogrammes et idéogrammes, les premiers servant
à composer les seconds et les derniers. Plus tard apparaîtront les idéophonogrammes qui
doivent également être pris en compte dans notre étude étymologique. Ces caractères primitifs, pour beaucoup d'une grande beauté,
peuvent être classés en pictogrammes, idéopictogrammes et idéogrammes, les premiers servant
à composer les seconds et les derniers. Plus tard apparaîtront les idéophonogrammes qui
doivent également être pris en compte dans notre étude étymologique.
N.B. : Toutes les calligraphies reproduites dans ces
pages sont de l'auteur. Celles apparaissant en noir sont tirées de fiches
établies par l'auteur il y a une vingtaine d'années, les calligraphies en
rouge ont été tracées spécialement pour cette conférence et ultérieurement.
Par ailleurs, nous n'avons pas utilisé pour illustrer le
présent exposé les caractères dits simplifiés utilisés aujourd'hui en
République populaire de Chine pour la simple raison que ces derniers ont pour
la plupart rompu le lien avec leur étymologie. Les caractères
"modernes" (ils datent tout de même du IIème s. de notre
ère !) que nous avons étudiés sont toujours utilisés à Taiwan, à Singapour,
dans la diaspora chinoise et... au Japon ("ganji" est la prononciation
japonaise des mots "caractères chinois").
|
