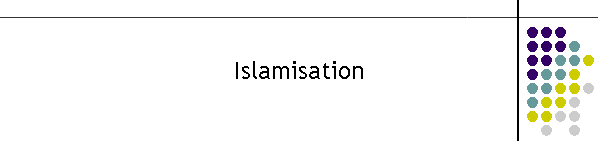
|
|
L’islamisation du Sud-Est asiatiqueL’archipel de l’Asie du Sud-Est a été occupée dès la dernière glaciation par des populations de type négroïde arrivées à pied du fait du bas niveau des mers. Beaucoup plus tard, lorsque se sont développés la navigation et le commerce, des peuples navigateurs ont progressivement occupé l’archipel, repoussant dans les montagnes la population aborigène. Ces populations, qui forment aujourd’hui encore la majorité des occupants de ces pays, parlent de très nombreuses langues appartenant presque toutes au groupe malayo-polynésien et plus précisément au sous-groupe malais dont font partie les langues indonésiennes. Avant l’islamisation, les religions répandues dans la région étaient essentiellement le bouddhisme (Theravada) et l’hindouisme. C’est depuis l’Inde que l’islam a pénétré l’archipel avant même de s’étendre à la péninsule de Malacca. Dès le XIIIème s., avec la création du sultanat de Delhi, il s’est répandu pacifiquement le long des côtes de Sumatra et de Java sous l’influence des marchands et de voyageurs soufis (courant spirituel, voire mystique né au Maroc, recherchant la rencontre entre le croyant et Dieu). Ce n’est qu’au XVIème s., au moment, précisément, où le sultanat de Delhi s’effondrait devant les hordes des Moghols, que des sultanats ont pris par les armes le contrôle des comptoirs de négoce. A mesure que la zone contrôlée par les sultans s’élargissait, le bouddhisme et l’hindouisme reculaient. Cette dernière religion n’est plus majoritaire qu’à Bali et dans l’île voisine de Lombok, tandis qu’il ne reste du bouddhisme que des communautés éparses. L’islam a été accueilli favorablement par des populations qui subissaient le système hindou des castes et qui voyaient en lui une religion de libération. En fait, il s’est superposé à un substrat de traditions anciennes, ce qui lui a conféré un caractère particulier, égalitaire et tolérant, non dénué de syncrétisme. En 1550, un sultanat dominant un ensemble de 500 îles était établi à Sulu (petit archipel méridional des Philippines) puis bientôt un autre à Mindanao (la grande île du sud des Philippines). Les musulmans progressaient vers le nord, soumettant les datus indigènes, lorsque débarqua en 1565 un Espagnol nommé Alfonso Legazpi. Ce dernier s’allia les datus rebelles à la domination musulmane, brisa l’avance de l’islam et entreprit de conquérir un à un les sultanats. La conquête espagnole ne sera stoppée qu’en 1663 par d’autres colonisateurs, les Néerlandais qui, après avoir pris possession de de Malacca dès le début du XVIème s. et de l'archipel indonésien au XVIIème s., étaient arrivés jusqu’à la province de Sabah. Jusqu’au XIXème s., les Néerlandais contrôleront la péninsule de Malacca et l’ensemble de l’archipel à l’exception des actuelles Philippines. C’est sous cette domination qu’est apparu le christianisme, surtout sous la forme luthérienne (la partie orientale de Timor est catholique). Ces chrétiens se regroupèrent progressivement en villages et devinrent même majoritaires dans certaines îles encore peu islamisées. En 1795, l'Angleterre occupa Malacca avec l'assentiment du roi Guillaume V de Hollande réfugié à Londres suite à l'invasion de son pays par les révolutionnaires français. En 1824, la cession de ce comptoir à l'Angleterre était ratifiée par le traité de Londres. Entre temps, les Anglais avaient fondé la colonie de Singapour. L'expansion anglaise dans la région du détroit de Malacca s'est poursuivie tout au long du XIXème s. et au début du XXème s., aboutissant à l'établissement de protectorats sur les sultanats de la péninsule et du nord de Bornéo. Quant aux Philippines, les Espagnols conservaient le contrôle des régions méridionales restées musulmanes et entretenant un système économique original, tandis que toutes les autres provinces étaient converties au catholicisme. Cela devait durer jusqu’à l’achat de la colonie par les Américains en 1898 à l’issue de la guerre contre l’Espagne. L’occupation japonaise allait bouleverser cette donne : des mouvements de résistance apparurent, s’appuyant les uns sur le nationalisme, d’autres sur le communisme, d’autres enfin sur l’islam. Après la victoire des Anglo-Saxons sur les Japonais, ces mouvements poursuivirent leur lutte pour une indépendance qui n’avait pas pour tous le même sens : création d’États nationaux pour les uns, libération marxiste pour les autres ou, pour d’autres encore, unification des peuples musulmans. Sukarno réussit à imposer la laïcité pour construire l’Indonésie tandis que les sultanats colonisés par les Britanniques firent le choix d’un nationalisme malais s’appuyant sur un islam identitaire. Les nationalistes philippins, catholiques, finirent par obtenir des Américains l’indépendance de leur pays mais héritèrent de la rébellion communiste (les Huks) et de la révolte musulmane. Comme dans beaucoup d’autres pays musulmans, la guerre soviétique en Afghanistan allait entraîner un mouvement de purification de l’islam : des moudjahiddin partis combattre aux côtés des Afghans furent en contact avec des musulmans arabes qui leur enseignèrent une vision plus orthodoxe de leur religion et revinrent en missionnaires d’un islam pur. Ce mouvement se renforcerait plus tard avec la formation de prêcheurs dans les madrasas pakistanaises et déboucherait enfin sur l’apparition d’un islam extrémiste et internationaliste incarné notamment par la Jemaah Islamiyah d’Abou Bakar Baashir. Aux Philippines, les divers mouvements moros apparaissent comme des organisations plus nationalistes qu’islamistes, même si le groupe Abou Sayyaf affecte de lutter pour l’unification de l’islam du sud-est asiatique sous un califat régional. |