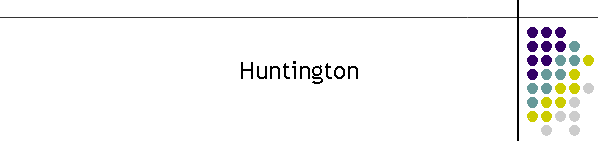
|
|
Chiens heureux ou choc des civilisations ?Avec l’effondrement de l’Union soviétique, la géopolitique, toujours présente dans les faits, a fait son retour dans les discours. Certes, « La fin de l’histoire » de Francis Fukuyama peut être considérée comme le chant du cygne d’une théorie des relations internationales fondée sur l’idéologie. L’idéologie communiste s’étant effondrée avec l’éclatement de l’Urss et la conversion de ses composantes et de ses alliés au libéralisme, tous les peuples n’allaient plus désormais avoir pour modèle la démocratie, les droits de l’homme et le libéralisme économique tels que les entendent les Américains. Dès lors, n’ayant plus de raisons de s’opposer, ils s’endormiraient comme un chien heureux dont tous les besoins sont assouvis. C’est bien entendu à la fameuse maxime de Hegel, « les peuples heureux n’ont pas d’histoire », que Fukuyama emprunte son titre. En revanche, « Le choc des civilisations » de Samuel Huntington est plus ambigu. Certes, la notion de civilisations vient à point nommé se substituer à celle d’idéologies pour délimiter les lignes de fracture. Huntington, en effet, distingue neuf grandes civilisations qu’il définit avant tout par la religion prédominante :
Le discours américain depuis le tragique 11 septembre 2001, encourageant les partisans de Huntington, même ceux qui ne l’ont jamais lu, a lui aussi un contenu hautement idéologique : lutte du bien contre le mal, axe du mal, croisade… Pourtant, il faut bien être honnête : les lignes de fracture que dessinent les civilisations ainsi que la répartition de ces civilisations sur le globe relèvent incontestablement de la géopolitique. Ces deux analyses de « La fin de l’histoire » et du « Choc des civilisations » sont-elles contradictoires ? Pas tellement, dans le fond. « La fin de l’histoire » ne décrit pas le monde d’après la fin de l’affrontement des blocs mais celui vers lequel, à son avis, nous marchons : un monde où la vision idéologique façon américaine de la démocratie, des droits de l’homme et du libéralisme économique s’imposera à tous. Ce sera alors l’avènement du temps du « chien heureux » qui s’assoupit paisiblement devant sa niche. Laissons de côté cette arrogance de promettre aux peuples autres que celui des États-Unis un destin de « chiens heureux » : il est après tout meilleur que celui de « chiens battus » que beaucoup doivent supporter. Quant à la théorie du « Choc des civilisations », elle peut être lue un peu comme l’apocalypse de Saint Jean : l’annonce du dernier combat, la bataille d’Armaguédon, avant l’avènement du royaume des « chiens heureux ». Puisque nous parlons de choc des civilisations, peut-être serait-il judicieux de commencer par là notre étude de la zone Asie-Pacifique. Laissons-nous, pour le moment, guider par Huntington. Depuis la fin de l’été 2001 plus que jamais, les tenants du choc des civilisations, croyant en cela être de fidèles disciples de Huntington, se réfèrent à l’idée d’un combat entre l’islam et le christianisme. Cela ne correspond ni à la théorie ni à la réalité. Le monde tel que le voit Huntington n’est pas organisé autour de quelques grandes religions mais autour de civilisations. Certes, il appelle certaines de celles-ci orthodoxe, islamique, bouddhiste, hindoue, mais d’autres sont désignées comme occidentale, latino-américaine, africaine, chinoise, japonaise. C’est qu’une civilisation se résume rarement à une religion, fût-elle largement majoritaire. La civilisation dite occidentale, qui recouvre l’Europe occidentale, l’Amérique anglo-saxonne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, plonge certes ses racines dans la religion chrétienne catholique ou protestante, mais aussi dans la philosophie des Lumières qui était loin de bénéficier du soutien des Églises, et a peu de rapports avec celle de ce pays catholique que sont les Philippines. D’ailleurs, Huntington distingue la civilisation sud-américaine, marquée pourtant par le catholicisme, de la civilisation occidentale. Quant à la civilisation orthodoxe, peut-elle être considérée comme non chrétienne ? Un pays comme la Chine est soumis à des influences religieuses diverses et mêlées : bouddhisme, taoïsme et confucianisme sans compter l’islam qui est propre aux minorités Ouïgour et Hui. C’est donc bien de civilisations qu’il s’agit, mais ces civilisations sont construites sur le fondement des religions. Il n’est donc pas inutile de commencer par faire le tour des religions qui sont présentes dans la zone Asie-Pacifique. Religions du complexe chinois (dans lequel, à la différence de Huntington, nous inclurons le Japon), islam de ce qui fut l’Insulinde (civilisation « malayo-musulmane), civilisation « occidentale » de l’Amérique du Nord, de l’Australie et de la Nouvelle Zélande, civilisation ibéro-américaine enfin. Je ne pense pas utile de parler de l’orthodoxie : la Russie est certes présente sur les rives du Pacifique, mais il ne semble pas que l’on puisse définir l’Extrême-Orient russe comme orthodoxe. |