|

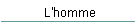


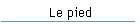


| |
17/04/2012
Idéogrammes comportant le pictogramme de la main
La main, plus particulièrement la main droite mais aussi la main cueillante,
est sans doute l'élément que l'on retrouve dans le plus grand nombre
d'idéogrammes.
 Deux
mains droites,
c'est déjà, au moins quinze siècles avant notre ère, la poignée de main, le
signe de l'amitié Deux
mains droites,
c'est déjà, au moins quinze siècles avant notre ère, la poignée de main, le
signe de l'amitié .
Vous êtes dubitatifs ? Regardez bien : une des deux mains droites est bien
reconnaissable en bas à droite. Quant au trait horizontal en haut, ce sont le
poignet et le doigt du milieu. Et les deux autres doigts ? Bien sûr, vous les
voyez à présent : c'est le trait oblique de gauche. .
Vous êtes dubitatifs ? Regardez bien : une des deux mains droites est bien
reconnaissable en bas à droite. Quant au trait horizontal en haut, ce sont le
poignet et le doigt du milieu. Et les deux autres doigts ? Bien sûr, vous les
voyez à présent : c'est le trait oblique de gauche.
 Moins
pacifique, cette main tient un bâton ou une verge. Le symbole d'autorité est
évident. Il s'agit du père Moins
pacifique, cette main tient un bâton ou une verge. Le symbole d'autorité est
évident. Il s'agit du père  . .
 Le
même symbole d'autorité accompagné du pictogramme de l'enfant. Le père,
encore ? Remarquez les deux croix au-dessus de la tête de l'enfant. Dans
plusieurs idéogrammes, ces croix désignent des caractères. C'est l'art de
l'écriture que l'on fait rentrer à coups de verges dans la tête de l'enfant !
Cet idéogramme signifie "enseigner" Le
même symbole d'autorité accompagné du pictogramme de l'enfant. Le père,
encore ? Remarquez les deux croix au-dessus de la tête de l'enfant. Dans
plusieurs idéogrammes, ces croix désignent des caractères. C'est l'art de
l'écriture que l'on fait rentrer à coups de verges dans la tête de l'enfant !
Cet idéogramme signifie "enseigner"  . .
 Ici
encore, ce que rassemblent ces deux mains, ce sont des caractères, la
connaissance. Cette action se déroule dans une maison, une école donc : il
s'agit du verbe "étudier", "apprendre". Dans le style
ultérieur des "petits sceaux" Ici
encore, ce que rassemblent ces deux mains, ce sont des caractères, la
connaissance. Cette action se déroule dans une maison, une école donc : il
s'agit du verbe "étudier", "apprendre". Dans le style
ultérieur des "petits sceaux"
 , on a cru bon d'ajouter l'enfant, ce qui nous conduit au caractère actuel , on a cru bon d'ajouter l'enfant, ce qui nous conduit au caractère actuel  . .
 Vous
avez reconnu la vache ou le buffle, ainsi que la main. Que tient-elle ? Par
assimilation avec le pictogramme de l'arbre, nous devinons qu'il s'agit d'un
végétal dont la ramure est un petit peu plus compliquée. Ne cherchons pas
plus loin, il s'agit d'une branche, d'une badine dirons-nous. Vous avez
parfaitement deviné : il s'agit du verbe "mener paître" Vous
avez reconnu la vache ou le buffle, ainsi que la main. Que tient-elle ? Par
assimilation avec le pictogramme de l'arbre, nous devinons qu'il s'agit d'un
végétal dont la ramure est un petit peu plus compliquée. Ne cherchons pas
plus loin, il s'agit d'une branche, d'une badine dirons-nous. Vous avez
parfaitement deviné : il s'agit du verbe "mener paître"  . .
 La
ressemblance entre cet idéogramme et le précédent saute aux yeux. Deux mains
tenant deux badines ? Non, mais nous n'en sommes pas loin. Il s'agit encore de
branchages mais plutôt dans le genre bouquets de genêts. Les trois points que
rassemblent ces deux bouquets, ce sont des détritus ou de la poussière. Oui,
ce caractère signifie bien "balayer". La
ressemblance entre cet idéogramme et le précédent saute aux yeux. Deux mains
tenant deux badines ? Non, mais nous n'en sommes pas loin. Il s'agit encore de
branchages mais plutôt dans le genre bouquets de genêts. Les trois points que
rassemblent ces deux bouquets, ce sont des détritus ou de la poussière. Oui,
ce caractère signifie bien "balayer".
 Que
saisit cette main cette fois ? Une oreille. Cela rend la notion de
"choisir", "accepter", "prendre" .
On comprend l'idée : le choix d'un animal dans un troupeau, mais aussi d'un
soldat pour une mission, en le prenant par l'oreille. Ce jiaguwen
est devenu le jinwen Que
saisit cette main cette fois ? Une oreille. Cela rend la notion de
"choisir", "accepter", "prendre" .
On comprend l'idée : le choix d'un animal dans un troupeau, mais aussi d'un
soldat pour une mission, en le prenant par l'oreille. Ce jiaguwen
est devenu le jinwen  puis le xiaozhuan
puis le xiaozhuan  avant d'aboutir au caractère
régulier
avant d'aboutir au caractère
régulier  . .
 Voici
un idéogramme tout à fait remarquable. On y reconnaît un homme accroupi à la
manière de la femme (mais il n'a pas les bras croisés sur la poitrine, c'est
donc bien un homme) et deux mains qui semblent extrêmement actives. Entre ces
mains, objet de cette activité, un arbre. Un arbre, vraiment ? Rappelons-nous
que ce pictogramme désigne aussi, par extension, le bois. Il s'agit donc d'une
pièce de bois. Ce très bel idéogramme désignait à l'origine l'artisan et un
glissement de sens lui fait également exprimer la notion d'art. Voici
un idéogramme tout à fait remarquable. On y reconnaît un homme accroupi à la
manière de la femme (mais il n'a pas les bras croisés sur la poitrine, c'est
donc bien un homme) et deux mains qui semblent extrêmement actives. Entre ces
mains, objet de cette activité, un arbre. Un arbre, vraiment ? Rappelons-nous
que ce pictogramme désigne aussi, par extension, le bois. Il s'agit donc d'une
pièce de bois. Ce très bel idéogramme désignait à l'origine l'artisan et un
glissement de sens lui fait également exprimer la notion d'art.
 Mais
que tient cette main-ci ? Une autre main ? Non, il s'agit d'un pinceau. En
dessous, une tablette reposant, semble-t-il, sur un chevalet. Il s'agit du verbe
"peindre" Mais
que tient cette main-ci ? Une autre main ? Non, il s'agit d'un pinceau. En
dessous, une tablette reposant, semble-t-il, sur un chevalet. Il s'agit du verbe
"peindre"  . .
 Ne
confondons pas le caractère précédent avec celui-ci. Les deux formes de jiaguwen
que nous avons relevées comportent encore une main tenant un pinceau. Un
pinceau ? Peut-être pas, après tout. en bas, sous la première forme, une
coupe à pied. Sur la seconde, ce qui ressemble à un mortier ou à un bol.
Cette seconde forme est intéressante car elle inclut encore deux points,
représentant quelque chose de ténu, un presque rien (gouttes, vapeur,
poussière dans d'autres caractères). Ce caractère est devenu Ne
confondons pas le caractère précédent avec celui-ci. Les deux formes de jiaguwen
que nous avons relevées comportent encore une main tenant un pinceau. Un
pinceau ? Peut-être pas, après tout. en bas, sous la première forme, une
coupe à pied. Sur la seconde, ce qui ressemble à un mortier ou à un bol.
Cette seconde forme est intéressante car elle inclut encore deux points,
représentant quelque chose de ténu, un presque rien (gouttes, vapeur,
poussière dans d'autres caractères). Ce caractère est devenu  ,
qui signifie "finir", "épuiser", "vider" et, par
extension, "accomplir", "tout à fait". On y reconnaît
aisément la main qui tient le "pinceau". Les quatre points pourraient
être les points de la seconde forme du jiaguwen ou des poils du pinceau.
Le chapeau de yeoman de la Tour de Londres, en bas, est la forme actuelle
courante de l'article de vaisselle (plat, bol). Comment interpréter ce
caractère ? A l'évidence, il s'agit de l'acte de vider la nourriture contenue
dans un bol, a priori en la mangeant. On s'attend donc à ce que la main
tienne des baguettes mais peut-être n'existaient-elles pas à l'époque. Une
fourchette ? Ce serait surprenant. Une brosse pour laver le bol ? Cela
n'expliquerait pas le sens d'accomplissement de ce caractère. Non, il s'agit
bien de manger jusqu'au dernier grain de riz mais nous ignorerons peut-être
toujours quel genre de couvert était utilisé à table. ,
qui signifie "finir", "épuiser", "vider" et, par
extension, "accomplir", "tout à fait". On y reconnaît
aisément la main qui tient le "pinceau". Les quatre points pourraient
être les points de la seconde forme du jiaguwen ou des poils du pinceau.
Le chapeau de yeoman de la Tour de Londres, en bas, est la forme actuelle
courante de l'article de vaisselle (plat, bol). Comment interpréter ce
caractère ? A l'évidence, il s'agit de l'acte de vider la nourriture contenue
dans un bol, a priori en la mangeant. On s'attend donc à ce que la main
tienne des baguettes mais peut-être n'existaient-elles pas à l'époque. Une
fourchette ? Ce serait surprenant. Une brosse pour laver le bol ? Cela
n'expliquerait pas le sens d'accomplissement de ce caractère. Non, il s'agit
bien de manger jusqu'au dernier grain de riz mais nous ignorerons peut-être
toujours quel genre de couvert était utilisé à table.
 La
"main cueillante" ou "griffe" au dessus d'un arbre ou autre
végétal portant des fruits ou grains évoque bien sûr la récolte ou la cueillette. Il s'agit bien du
verbe "récolter", "cueillir" La
"main cueillante" ou "griffe" au dessus d'un arbre ou autre
végétal portant des fruits ou grains évoque bien sûr la récolte ou la cueillette. Il s'agit bien du
verbe "récolter", "cueillir"  . .
 Cette
main tient non pas une cuiller mais une mailloche. Sur quoi frappe-t-elle ? Sur
un tambour dont on distingue clairement le support et le couronnement. Essayez
de vous représenter les gros tambours chinois reposant horizontalement sur un
appareillage décoré, c'est bien ce qui apparaît sur ce caractère qui
signifie "battre le tambour" ou, plus simplement, "tambour" Cette
main tient non pas une cuiller mais une mailloche. Sur quoi frappe-t-elle ? Sur
un tambour dont on distingue clairement le support et le couronnement. Essayez
de vous représenter les gros tambours chinois reposant horizontalement sur un
appareillage décoré, c'est bien ce qui apparaît sur ce caractère qui
signifie "battre le tambour" ou, plus simplement, "tambour"
 .
On retrouve le tambour, sans la main à la mailloche, dans l' idéogramme "bonheur". .
On retrouve le tambour, sans la main à la mailloche, dans l' idéogramme "bonheur".
 Ce que saisit cette main, c'est un cauri, symbole, on
l'a vu, de la monnaie et de la richesse. Cet idéogramme signifie
"obtenir", "acquérir". Sous la seconde forme, on y a
ajouté deux traits qui expriment en général le fait de marcher. Est-ce parce
qu'il faut se déplacer pour obtenir ce que l'on veut ? Toujours est-il que
cette seconde forme est à l'origine du caractère actuel
Ce que saisit cette main, c'est un cauri, symbole, on
l'a vu, de la monnaie et de la richesse. Cet idéogramme signifie
"obtenir", "acquérir". Sous la seconde forme, on y a
ajouté deux traits qui expriment en général le fait de marcher. Est-ce parce
qu'il faut se déplacer pour obtenir ce que l'on veut ? Toujours est-il que
cette seconde forme est à l'origine du caractère actuel  . .
 Ce
qui accompagne ici la main, c'est la langue, qui
symbolise la parole. La main, signe de l'action, semble tenir cette dernière.
La parole et l'action, c'est une affaire, une chose abstraite. Ce pictogramme et
cet idéopictogramme sont toujours reconnaissables dans l'idéogramme actuel Ce
qui accompagne ici la main, c'est la langue, qui
symbolise la parole. La main, signe de l'action, semble tenir cette dernière.
La parole et l'action, c'est une affaire, une chose abstraite. Ce pictogramme et
cet idéopictogramme sont toujours reconnaissables dans l'idéogramme actuel  . .
 Que
se disputent donc ces deux mains ? Une corde ? Jouait-on donc au tir à la corde
dans l'antiquité chinoise ? Toujours est-il que cet idéogramme Que
se disputent donc ces deux mains ? Une corde ? Jouait-on donc au tir à la corde
dans l'antiquité chinoise ? Toujours est-il que cet idéogramme  signifie "se disputer quelque chose", "se battre pour
quelque chose".
signifie "se disputer quelque chose", "se battre pour
quelque chose".
 Deux
mains ne se disputent pas nécessairement un objet. Elles peuvent aussi le
partager. C'est ce qu'exprime ce jiaguwen
: le carré est une représentation courante dune marchandise. Dès l'époque de
l'écriture sur bronze, on a
interprété ce carré comme une bouche, ce qui a donné
le jinwen Deux
mains ne se disputent pas nécessairement un objet. Elles peuvent aussi le
partager. C'est ce qu'exprime ce jiaguwen
: le carré est une représentation courante dune marchandise. Dès l'époque de
l'écriture sur bronze, on a
interprété ce carré comme une bouche, ce qui a donné
le jinwen  .
Dans le style des "petits sceaux",
le trait horizontal de la bouche s'est allongé : .
Dans le style des "petits sceaux",
le trait horizontal de la bouche s'est allongé : .
Cela nous conduit, les deux mains se rejoignant, au caractère régulier .
Cela nous conduit, les deux mains se rejoignant, au caractère régulier  dont le sens demeure "commun".
dont le sens demeure "commun".
 Finissons
cette énumération des idéogrammes mettant en action la main avec celui-ci,
magnifique. Nous en avons recensé six formes, où l'on reconnaît sans peine
une main guidant un éléphant par la trompe. La fragilité mettant en action la
puissance : c'est "agir" Finissons
cette énumération des idéogrammes mettant en action la main avec celui-ci,
magnifique. Nous en avons recensé six formes, où l'on reconnaît sans peine
une main guidant un éléphant par la trompe. La fragilité mettant en action la
puissance : c'est "agir"  ,
rien de moins ! Le symbole n'est-il pas extraordinaire ? C'est ce caractère que
les taoïstes utilisent dans le précepte wuwei, le "non agir". ,
rien de moins ! Le symbole n'est-il pas extraordinaire ? C'est ce caractère que
les taoïstes utilisent dans le précepte wuwei, le "non agir".
   |
